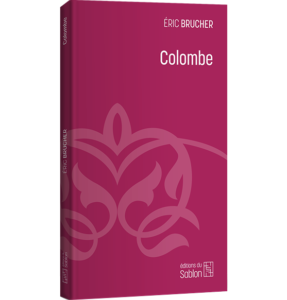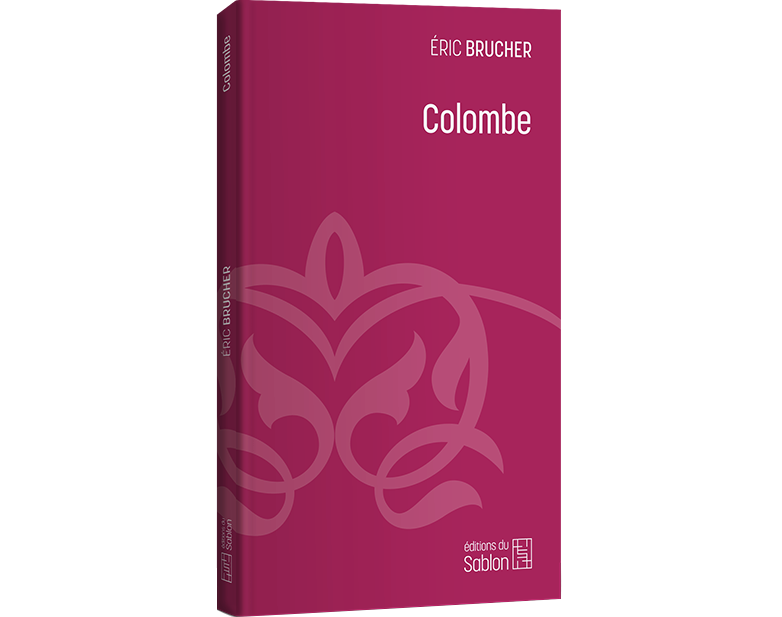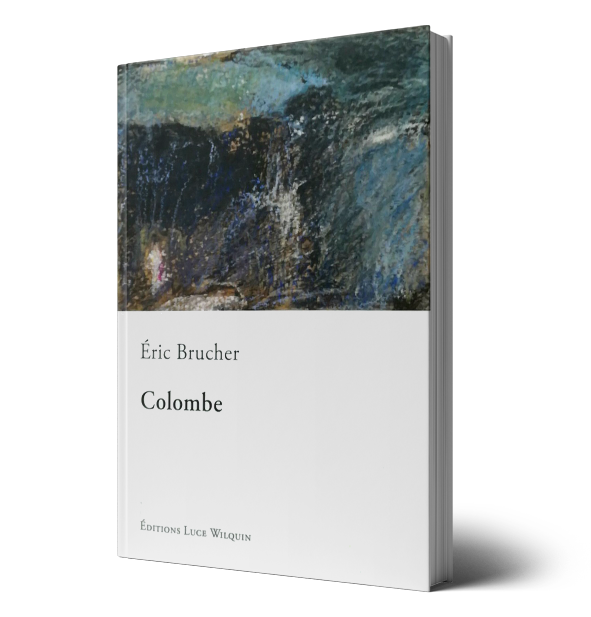« Les adolescents jouent souvent avec la nourriture. Ils chutent parfois dans l’anorexie. On dit des anorexiques qu’ils refusent de se nourrir alors qu’ils refusent simplement, sainement, d’avaler de mauvaises nourritures. On les dit malades quand ils ne font que rejeter l’amour avarié qu’on les invite à goûter. Écrire, c’est devenir anorexique. Écrire, c’est refuser les aliments proposés par le monde et rechercher, dans la maigreur affolante d’une phrase ou dans son développement boulimique, la vraie nourriture, celle qui fera grandir, et cette recherche par elle-même est déjà nourricière. »
Christian Bobin, L’épuisement (Le Temps qu’il fait, 1994).
Lire évidemment aussi La faim de l’âme de Jacqueline Kelen (rééd. revue et augmentée aux Presses de la Renaissance, 2012).
Questions de Baudouin Delaite (éditions du Sablon) pour Colombe
Comment est née l’idée de ce roman ?
Je ne sais pas si l’on fait un roman avec des idées. Mais avec des mots, des phrases, des images, des sensations – et pour moi, il y a quelque chose de très intuitif et au fond pas tellement réflexif dans le geste ou dans cette sorte de pulsion d’écrire : « quelque chose » pousse du dedans. Le roman est né de la toute première phrase, justement. Je me la suis un jour formulée, la prononçant à voix haute – c’était un début d’après-midi d’hiver glacial avec le ciel d’un bleu magnifique, la lumière du dehors m’attirait tellement tandis que j’étais enfermé au travail, et je voulais comme boire cette lumière. Une collègue m’a dit « Éric, ce sera le début de ton prochain roman », c’était une parole prophétique. J’ai voulu explorer ce que cette phrase avait dans le ventre (!), et ce qui se passait en moi lorsqu’il me prenait l’envie de ne pas manger. Autrement dit aussi, il n’y a pas de témoignage quelconque que j’aie cherché à adapter. Un livre, en outre, est toujours la synthèse d’un ensemble d’éléments que l’on éprouve ou qui nous « travaillent » à un moment donné, et il y avait alors les Gnossiennes d’Érik Satie que j’aimais écouter, il y avait la toile de Magritte La grande famille, il y avait une élève nommée Paola (qui n’a rien à voir avec mon personnage) que je charriais en l’appelant Paloma, ou Antigone que je travaillais en classe…
Sans vraiment le nommer ainsi, il y est question sinon d’anorexie, tout au moins de trouble de l’alimentation. Pourtant Colombe, le personnage principal de ce roman, ne le voit pas de cette manière. Elle ne semble pas, à ses propres yeux, ‘souffrir’ d’un mal. Ce serait plutôt pour elle la manifestation de son élan vers une forme d’absolu. Serait-ce sa force de résilience qui lui donne cette perception ? Ou une manière de se rebeller sans violence ? Mais les deux sont peut-être liés ? Dès lors, la résilience, le vrai sujet de ce roman ?
Le vrai sujet, je crois, est ce désir d’absolu, ce désir d’être plongé dans le « tout », de s’y fondre. Ce désir d’envol et d’apesanteur, de ciel ou d’élévation, cet « instinct d’ailleurs » – cela que nous éprouvons tous, il me semble, peu ou prou, jusqu’à cette expression de désirer « s’envoyer en l’air », ne plus être assujetti aux contingences et contraintes matérielles. Il s’agit dans son essence d’une aspiration spirituelle, je crois. Et cette aspiration me paraît (comme je l’éprouve moi-même, mais on en retrouve l’expérimentation chez nombre de personnes) être corrélée au désir de ne plus manger, c’est-à-dire au fond de s’imposer un jeûne. Toutes les traditions spirituelles ont intégré cet aspect dans leurs pratiques ; y compris aujourd’hui, au sein de notre matérialisme, au travers des cures « détox » ou des stages de jeûne, comme si cela répondait à un profond besoin. Bien entendu, cette démarche (qui se pose en rupture avec le matérialisme consumériste aujourd’hui ou, dans les traditions, avec la seule réalité biologique) nécessite un encadrement. Et il me semble que chez mon héroïne Paola-Colombe, si elle « chute » dans quelque chose qui ressemble à de l’anorexie, c’est à cause d’un déficit de cadre ou d’accompagnement – celui-ci qu’elle découvrira dans la seconde partie du livre au travers de personnes bienveillantes et écoutantes ; celles-ci l’amèneront vers des activités qui lui permettront de canaliser ce désir sans qu’il ne se retourne plus contre lui-même.
Je n’adhère pas nécessairement ici à la notion de « résilience ». Bien entendu, ce que ce mot recouvre est tout à fait précieux : cette capacité à trouver en soi les ressources afin de résister au malheur ou de rebondir malgré les douleurs ou une situation extérieure néfaste. Je ne suis même pas certain que le terme soit approprié au « cas » de Paola : pour moi, elle ne change pas au sens où elle ne renonce pas, dans la deuxième partie du roman, à son désir, elle conserve toujours cette tension vers le « ciel » ; c’est essentiellement le milieu autour d’elle qui a été modifié et qui permet que ce désir puisse être accompagné/canalisé, qui lui permet aussi de mieux apprivoiser cette force d’absolu en elle qu’elle expérimentait auparavant de manière un peu sauvage. Si le milieu n’avait pas changé, Paola aurait-elle pu « rebondir » ?
Paola n’est certainement pas une « malade » : vouloir s’échapper du corps, de la matière et de sa pesanteur, autrement dit aussi échapper au biologique et à ses conditionnements, me paraît une forme d’instinct tellement présent chez chacun (même si pour cela on utilise le corps lui-même, comme dans l’amour et l’érotisme, même si on ne se le reconnaît pas toujours…) Les grands saints et sages se nourrissent de peu… Est-ce que les « saintes jeûneuses » des temps anciens ne passeraient pas aujourd’hui pour des anorexiques ? Au fond, ce « trouble de l’alimentation » n’est-il pas le signe d’un monde qui a perdu contact avec le « ciel » ou avec une dimension spirituelle de la vie, monde « rabaissé » dans un matérialisme réducteur ? (En ces temps de confinement où la culture paraît ne pas être un « essentiel », ne souffrons-nous pas radicalement de n’être ramenés qu’à la réalité du corps, à la santé du corps – cette dimension très partielle de la santé – et à la seule survivance biologique par la succession harassante dans les médias des seuls virologues, épidémiologistes, infectiologues … ? L’enfer, n’est-ce pas d’être enfermé dans la seule réalité matérielle et biologique ?)
Du reste, comment ne pas devenir anorexique, si l’on a un peu de conscience, quand on voit la quantité de nourritures avariées et toxiques qui nous sont proposées (nourritures alimentaires mais aussi médiatiques ou de « divertissement »)… ?
Oui, très certainement, Paola éprouve viscéralement une rébellion, se pose en dissidence de certains aspects de ce monde, notamment sa dimension devenue strictement matérielle, ou en dissidence également d’un monde qui a permis « ça », l’horreur absolue de la Shoah : comment accepter de participer à l’humanité lorsqu’il y a « ça » ? Du moins, sont-ce ces questions qui, encore une fois sans être accompagnée, font se retourner contre elle-même son aspiration. Il y a des images qui coupent littéralement l’appétit. Il y aurait ici comme une forme d’« anorexie politique », comme il existe des grèves de la faim ou des jeûnes de revendication. Plutôt qu’une résiliente, Paola est une résistante-dissidente ; j’aime bien la proposer comme une petite Antigone, l’héroïne de l’intégrité qui lutte pour son devoir sacré.
Enfin, plutôt que de résilience, je me sentirais plus proche d’évoquer Saint-Exupéry et « Mozart assassiné », ce génie en chacun telle une rose que l’absence de jardinier empêche d’épanouir… Sans doute donc y a-t-il ici une responsabilité relationnelle et sociétale davantage qu’individuelle : comment ce désir d’absolu peut-il être aujourd’hui guidé et accompagné ?
Sa relation avec sa mère est particulière. Sans être violente – il n’y a pas de place pour la violence dans votre roman- cette relation n’en est pas moins assez radicale (elle appelle sa mère par son prénom…). Pourquoi cette tension ?
Je ne le sais pas au moment où j’écris. Encore une fois, le moment de l’écriture est un moment intuitif où je « sens » que les choses ont du sens si elles se passent de cette façon ; et la rationalisation ou le retour réflexif comme je le fais ici est postérieur. De ce fait aussi, je n’ai pas de sens tout fait à plaquer sur l’histoire : le lecteur est libre dans ses interprétations. Mais pour moi, y réfléchissant donc après coup, en appelant sa mère par son prénom (ce qui est en effet violent), Paola refuse ce que celle-ci représente pour elle : sans doute d’abord un côté qu’elle perçoit comme superficiel, tel que son culte du corps, son fitness, et son monde un peu vain, selon elle. J’imagine que Paola refuse également le principe même de maternité (ne pas jouer le jeu de la « reproduction », c’est-à-dire aussi ce modèle qui « reproduit » toujours le même schéma et qui est celui qui mène à l’horreur absolue ; ou même la place de mère traditionnellement dévolue à la femme) – au fond, ce seront les vieilles dames (libérées justement par leur âge de la question de la procréation) qui vont l’ « engendrer », c’est-à-dire la mettre au monde dans son être et sa vérité, de manière vraiment vivante et l’incarner : ces vieilles dames, le « chœur des anges », font naître Paola une seconde fois, c’est-à-dire en plénitude. (Et je pense à toutes ces vieilles personnes enfermées dans leurs homes-mouroirs qui n’ont plus l’occasion de jouer ce rôle vis-à-vis de leurs petits-enfants.) Enfin, dans l’opposition à sa mère, j’imagine qu’il y a aussi le conflit générationnel propre à l’adolescence
Elle semble aussi idéaliser un père qui est pourtant le grand absent de leur histoire. Mais une absence, si souvent relevée, est une manière de présence…
Sans doute pour une jeune fille, le père est souvent idéalisé… Je pense surtout que l’absence du père est parallèle à l’absence de Père. Nous sommes orphelins de Père et le Ciel est vide… Nous sommes orphelins de transcendance, de réflexion et d’expérimentation métaphysique (comme si la question avait été réglée une fois pour toutes). Je ne suis pas en train de demander le retour d’un Dieu le Père ! Je suis bien heureux que « Dieu soit mort », Dieu merci, au sens où l’on a pu enfin, après des siècles d’oppression, évacuer le tyran culpabilisant et menaçant, et l’on s’est à juste titre émancipés du cléricalisme. Mais enfin, cela n’a pas tout réglé : l’aspiration au « ciel » persiste, cet « instinct secret » que disait Blaise Pascal demeure – et il n’est bien entendu aucunement question, selon moi, de quelque triste et pathétique nostalgie fœtale ; il s’agit de la réalisation de son être profond. Nous sommes orphelins et n’entendons plus parler d’être mais de bien-être, non plus d’éternité mais de durable, non plus de vivre mais de profiter de la vie, non plus d’effort ou de transformation de soi mais de prendre soin de soi, non plus de salut mais de santé… La «mort de Dieu», malgré ses dimensions libératrices, a au fond laissé la société dans une sorte de tétanisation et de stress puisqu’il n’y a plus rien qui puisse donner la moindre signification à la mort.
Ce que le papa de Paola aura appris à sa fille surtout, c’est, avec le jeu du cerf-volant, de ne pas perdre la connexion au ciel, de conserver cet autre cordon ombilical qu’est le câble du cerf-volant que l’on tient en main et qui nous relie à cet « ailleurs ».
Encore une fois, avec le mot « anorexie », c’est comme si l’on réduisait l’aspiration à l’absolu (et la faim que l’on s’impose qui l’accompagne ici) à une maladie, comme une médicalisation de nos états d’âme et de nos tourments (inguérissables) de « ciel » ou soifs métaphysiques. Ce siècle médicalise toute chose et les ravale au ras des pâquerettes. Comment ne pas en être très malheureux ?
Un personnage féminin se prête à merveille à ce genre d’intériorisation. En tant qu’auteur masculin, quelle fut pour vous la principale difficulté à vous mettre dans la peau et dans l’inconscient d’une adolescente ?
Le choix d’un personnage féminin s’est fait spontanément, cela me paraissait naturel. Sans doute afin de mettre la chose à distance de moi-même (puisque je partais de ce que j’éprouvais), l’observer et la traiter plus facilement à distance. Aussi, j’imagine, parce que cette question de ce qui devient un trouble de l’alimentation affecte proportionnellement davantage les jeunes filles (il y a des garçons également, bien sûr – mais ils « métabolisent » leur dissidence souvent différemment).
Je n’ai éprouvé aucune difficulté à me mettre dans la peau de Paola (je ne plagierai pas Flaubert en disant « Paola-Paloma, c’est moi » !), et j’imagine que c’est parce qu’il y a en moi une « dimension féminine » un peu plus prononcée. De toute manière, écrire et proposer des personnages, qu’ils soient masculins ou féminins, suppose une sorte de « projection empathique » – et c’est cela qui est passionnant, se projeter et se fondre dans la réalité, le corps et l’esprit de tel ou tel personnage, on s’oublie un peu soi-même pour rencontrer l’altérité.
La question m’a été posée par une jeune lectrice en classe : celle de l’offense. Question très contemporaine – au fond très dans la tendance woke, cette mentalité qui se dit éveillée aux structures oppressives dans la société, notamment racistes et sexistes, et cherche à les déconstruire. C’est-à-dire que, écrivant à propos de ce que je ne puis connaître (puisque je suis homme et que j’écris à propos d’une jeune femme), je pourrais «offenser» une lectrice qui aurait vécu ce dont je parle dans le livre et qui ne s’y retrouverait pas, qui s’en sentirait comme trahie, ou blessée et dès lors offusquée… C’est en même temps la question de la légitimité : un homme (en outre bien plus âgé) est-il légitime pour parler de ce que peut vivre et éprouver une jeune fille ? « De quoi je me mêle ?», en quelque sorte. Ou même comme si je volais, pour m’en nourrir, la douleur d’autrui dont je le désappropriais, que j’exerçais même un abus de pouvoir (l’on semble n’être pas loin non plus de la question de l’appropriation culturelle). Plusieurs choses à dire. La plus importante est celle-ci : la littérature est du côté de l’amour. L’empathie, ressentir ce que d’autres ressentent, est le fondement de l’humanité. Comme je le disais plus haut, l’écriture procède d’une projection empathique, celle qui fait se mettre à la place d’autrui pour le comprendre. On est amené à faire la même chose dans la lecture : celle-ci nous fait voir, sentir, percevoir, comprendre par les yeux de personnages divers, c’est-à-dire d’autres entités que nous-même, elle nous décentre vers l’altérité et nous ouvre les horizons du monde et de l’esprit. N’est-il pas légitime de chercher à comprendre et aimer ? Flaubert, parce qu’il n’était pas de sexe féminin, ne pouvait-il raconter Emma Bovary et son mal-être ? Comme être humain, nous possédons chacun et chacune tout ce qui le constitue : la sainteté et la monstruosité, le masculin et le féminin, etc. – et chacun est légitime à écrire, dans la fiction, à propos de tout. Pourquoi s’en sentir offensé ? (Offense : sentiment toujours un peu autocentré, voire narcissique.) Du reste, nul ne force quiconque à lire tel ouvrage ; ou même, étant forcé (cf. situation de classe), lire ouvre toujours au risque d’être bousculé, de sortir de sa zone de confort, d’apprendre. Enfin, est-il réaliste de penser qu’un auteur, sans même vouloir offenser quiconque, puisse tenir compte (et d’ailleurs connaître) la sensibilité à fleur de peau et les blessures intimes de lecteurs… qu’il ne connaît évidemment pas ? Ou alors il n’écrit plus rien. On comprend que ce sentiment d’offense (et derrière lui sans doute une demande de bienveillance mal comprise) ouvre tout droit à l’auto-censure, à la mort de la liberté d’expression, à la fin de la littérature ou de toute expression artistique.
Une autre question que l’on m’a posée plusieurs fois : ne craignez-vous pas que votre livre attire vers l’anorexie une série de jeunes filles ? Comme s’il y avait donc une esthétisation de la maladie ? Peut-être, oui, il y a toujours un risque – et sait-on jamais ce qu’une œuvre provoque chez son récepteur, l’auteur en est-il responsable ? C’est une question très intéressante, il me semble pourtant qu’elle est tout habitée de crainte. Celle-ci, sans doute compréhensible, ne provient-elle pas de celles et ceux qui redouteraient de peiner à accompagner le cri silencieux dont témoigne cette faim volontaire ? Plutôt que chercher ses propres ressources d’accompagnement, écouter, voire remettre en question sa propre perspective, l’on voudrait faire taire cela qui risque de la perturber… ? Il me semble en outre que le livre peut donner à de telles jeunes filles le sentiment d’être entendues et alors justement ne pas sombrer dans des formes pathologiques. Le livre a, m’a-t-on dit, été utilisé dans des formes de thérapie par l’expression de jeunes filles anorexiques – et c’est une de mes fiertés les plus grandes. J’ai reçu des témoignages de jeunes femmes anorexiques se reconnaissant dans le livre et me remerciant… Et j’avoue que ces témoignages m’ont fait du bien et rassuré, car au moment de faire paraître le livre, je me rendais bien compte que le propos pouvait être périlleux. J’ai même reçu un courrier d’une madame se prénommant Colombe (!) et se reconnaissant complètement dans le livre : cela est source d’immense étonnement pour moi, d’admiration et de joie.
Un autre motif de joie, en outre, a été de recevoir de l’Académie royale le Prix Sander Pierron. Cette reconnaissance est très gratifiante, mais c’est surtout autre chose. Car le jury de ce prix était composé notamment de feu Jacques De Decker (victime précoce du Covid !) et de feu Guy Vaes : au moment d’attribuer le prix, celui-ci était en phase terminale, et cela me touche infiniment de pouvoir croire que ce livre a pu adoucir ses derniers jours, consoler sa fin de vie en proposant une perspective de lumière (et que c’est la raison qui l’a poussé à attribuer le prix à Colombe).
La deuxième partie de ce roman aborde le retissage des liens sociaux, des liens amoureux et même du renouement ou de la découverte d’une dimension spirituelle au sens large (c’est-à-dire plus large que l’aspect purement religieux). D’une certaine manière, cet optimisme, cette confiance qui guident Colombe et la bienveillance qui l’entoure font toute la beauté et toute la force de ce roman. Peut-on dire en ce sens que c’est un roman de ‘spiritualité’ ?
Oui, vous pouvez dire cela – mais c’est votre liberté d’interprétation, d’autres y verront peut-être une indécrottable neurasthénique, une irrémédiable malade ou hystérique mortifère, même si, comme vous le notez très justement, Paola-Colombe retisse des liens. Elle se réconcilie surtout avec la vie, son corps, son histoire, sa famille (découvrant les secrets et non-dits dont on peut se demander quelle en a été l’incidence sur sa « maladie », c’est-à-dire la transmission d’une « blessure » tans-générationnelle), et en particulier grâce à l’amour, la nature et la beauté. Nous savons bien, en ces temps de quasi-confinement, que culture et beauté (heureusement les livres sont disponibles et les musées !) nous sont essentiels pour trouver à respirer et trouver un horizon, que les balades en forêt ou dans la campagne sont régénératrices, que chérir les quelques liens que nous pouvons est source de joie profonde ! Paola émerge à elle-même, son être advient à la vie grâce à la nature et aux mains dans la terre, et grâce à un mode d’expression artistique, ici le chant qui est l’art sans doute le plus « vertical » reliant terre et ciel au travers du souffle. Le corps peut ne plus être un tombeau seulement, mais un temple. Et par le fait aussi, pour Paola, de s’occuper d’une vieille dame – Séraphine – , c’est-à-dire en se décentrant de soi au bénéfice d’autrui.
Bien entendu aussi, tout dépend de ce que l’on met derrière les mots… On parle aujourd’hui parfois de « spiritualité athée » ; or il s’agirait ici d’une spiritualité spiritualiste ! Ou comment vivre la dimension spirituelle que nous ressentons vibrer en nous dans un monde athée ? (J’aime beaucoup par ailleurs l’athéisme qui permet de nettoyer et décaper toutes les images réductrices, elles aussi, que l’on peut mettre derrière ce mot compliqué « Dieu » – un gros mot, bigre !, plein de quantité de projections…)
Votre écriture est très fine, souple et très juste, avec souvent de très belles nuances poétiques. On pourrait presque la qualifier de féminine. Votre style a-t-il dû s’adapter à l’intériorité de cette adolescente ?
Cela s’est fait spontanément également, du moins après ce que j’imagine un temps de maturation ou de « gestation ». L’expression artistique est très gratifiante pour un homme qui peut enfin porter comme en son ventre et « accoucher » d’un travail ou d’une œuvre qui, tel un enfant, va grandir, faire des rencontres, s’émanciper de son auteur dans l’interprétation qu’en fera le public.
Je crois que lorsque l’histoire est mûre, l’écriture trouve sa manière adaptée. Il y a des variantes stylistiques en fonction de ce qui est raconté et des personnages (en tout cas dans mon cas). Mon roman suivant La blancheur des étoiles (indisponible désormais dans le commerce) mettait en scène une jeune fille également mais fort différente, et donc le ton et le style devaient être mêmement différents. Et c’est drôle, avec ce roman, c’était explorer le ventre encore, non plus par le creux de la faim mais par le plein de la grossesse. Deux questions me paraissent toujours essentielles au moment d’entamer le roman : le point de vue en « je » ou en « il », et la temporalité, imparfait de narration ou présent… Cela me paraît toujours crucial, et l’histoire trouve son allant et son allure lorsque ces choix sont posés, il faut sentir ce qui convient et permet à l’histoire d’advenir…
Ici, il fallait trouver une écriture comme « dégraissée », ce qui donne sans doute cette dimension poétique.
Parmi les écrivains d’hier et d’aujourd’hui, quels sont vos modèles ?
J’ai trois grands inspirateurs contemporains : J.M. Le Clézio, Yannick Haenel, Sylvain Tesson. Le Clézio m’a fait découvrir une langue où je me sens chez moi et qu’écrire était possible. Haenel me fascine par sa sorte de folie en quête d’épiphanies sous des feuillages mauves et des pluies de pétales crépitantes. Tesson, un autre fou et aventurier (il s’est cassé la gueule comme ça), son côté acerbe, sans concession, et son rapport à la nature. Michel Tournier m’a également été inspirant, en particulier par sa revitalisation de grands mythes et l’importance accordée aux contes. Le livre qui a peut-être été le plus important pour moi est Jonathan Livingston Seagull de Richard Bach…
Comment êtes-vous venu à l’écriture, comment naît en vous la nécessité d’écrire ?
Rien autour de moi ne me prédisposait vraiment à l’écriture. Sans doute je désirais cela sans le savoir vraiment, je crois que j’avais le goût des mots pourtant (j’ai fait la philologie romane tout de même). C’est la découverte de Le Clézio (Désert) à la fin de mes études qui a été un déclencheur : si l’on pouvait écrire de cette façon, dans une langue où je me retrouvais totalement et reconnaissais comme mon pays, je pouvais tenter d’aller dans cette direction. Alors je me suis exercé. Et puis il y a Rimbaud et Flaubert et Pascal, et les lectures que je me suis mis à augmenter… Et des regards bienveillants et encourageants. Je suis venu assez tard à l’écriture parce qu’il a sans doute fallu mûrir et aussi lorsque les charges familiales (je me suis beaucoup occupé de mes trois enfants) et professionnelles ont commencé à s’alléger. Aujourd’hui, tandis que j’ai longuement cru que je pouvais m’en passer, écrire m’est devenu une nécessité.