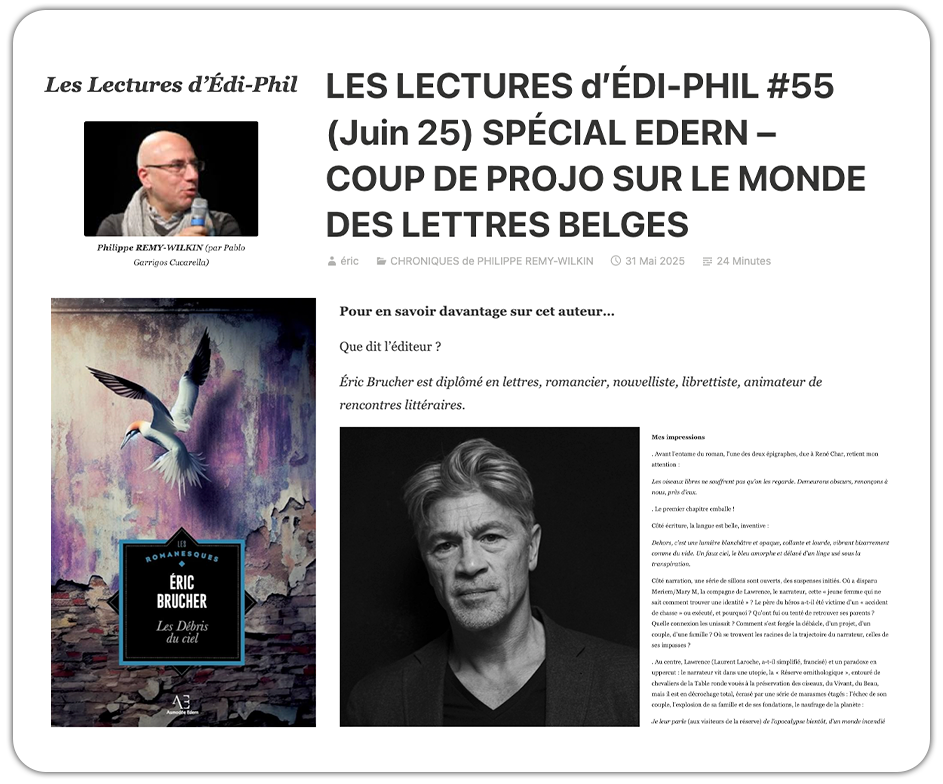Davantage qu’ornithologue, je suis ornithophile de longue date, un demi-siècle aujourd’hui. Les oiseaux m’ont toujours accompagné, ils m’ont enchanté, inspiré, consolé, mis en joie. Lorsqu’on a ce recul, on se rend compte de leur disparition : autant en variété que surtout en quantité. En 1962 déjà, la biologiste Rachel Carson redoutait un Printemps silencieux.
Au moment où j’en ai commencé l’écriture, je me rappelle m’être demandé, dans la violente déglingue environnementale ambiante, quel pouvait encore être le sens d’écrire un roman : cela pouvait sembler si futile tandis que de graves urgences requéraient toutes nos énergies, un peu comme ces théologiens byzantins devisant du sexe des anges tandis que l’ennemi abattait les murailles de la ville.
Au fond, j’étais pris de solastalgie, ce concept créé par le philosophe Glenn Albrecht en 2003 inspiré du mot « nostalgie » ; du latin solacium (le réconfort, le soulagement) et du suffixe grec algia (relatif à la douleur). La solastalgie désigne littéralement la douleur de la [perte de] consolation, celle que procure la nature ; détresse ou angoisse devant les changements environnementaux, la dégradation de son habitat ou de sa terre, face aux altérations et transformations négatives (ou vécues comme telles) subies par l’environnement. Une nostalgie projetée sur le futur (on parle parfois d’éco-anxiété mais le terme semble trop réducteur) ou celle d’un temps où la nature n’était pas en cours d’extinction, et qui affecte la santé mentale puisqu’être privé du réconfort de la nature (c’est-à-dire d’une nature authentique, belle et diverse) génère une puissante douleur existentielle. Le blues puissant de se sentir exilé tout en demeurant chez soi.
Comment ne pas éprouver ce sentiment ? N’est-ce pas un état normal pour qui se soucie de son milieu et biotope ? Ce qui me paraîtrait terrible, c’est que l’on puisse ne pas intensément éprouver ce mal. Comment, face à une planète où le vivant est en voie d’extinction, alors que notre arrogance inconséquente ou inconsciente lui a infligé tant de plaies, comment ne pas être profondément, viscéralement ému par l’effondrement en cours : est-ce somnambulisme, idiotie ou déni ? In fine, ce sentiment me fait aussi songer à une forme de deuil auquel devoir se résoudre.
Le terme «éco-anxiété» me paraît en effet réducteur, voire péjoratif : comme une psychologisation des enjeux environnementaux et socio-climatiques qui reporte le souci sur les individus et évite la remise en question du système destructeur ; presque une pathologisation discréditant les opposants au système et dépolitisant la question. Comme s’il était normal de vivre dans un monde abîmé.
Je n’aime pas non plus parler d’« environnement », car l’humain se pose toujours au centre, en monarque prédateur condescendant. Non plus que « biodiversité », réducteur ou technique (voire euphémistique). Il me semble meilleur et plus juste de parler de « vivant ». Car il s’agit de cela, de la destruction à grande échelle en cours du vivant sur la planète – mais, au fond, qui ne le sait pas aujourd’hui ?
J’éprouve toujours cette solastalgie. La douleur reste vive quoique moins encolérée, un peu moins anxieuse, un peu plus apaisée – c’est le bénéfice que m’a procuré la rédaction de ce roman et j’aimerais espérer que le lecteur y trouve également un apaisement.
Je viens d’écrire « j’aimerais espérer », et Les Débris du ciel oscille justement, me semble-t-il, entre espoir et désespoir. Quelques mots à leur sujet. Car il y a, me semble-t-il, un bon usage du désespoir comme il y a un mauvais usage de l’espoir.
Le désespoir peut paralyser et nous faire dire « à quoi bon ? » Le pessimisme risque d’encourager l’inaction et devenir même une sorte de prophétie auto-réalisatrice. « Le risque est que le pessimisme devienne un facteur en soi de la disparition des organismes et écosystèmes », a pu écrire l’océanologue Nancy Knowlton. Les forces contre lesquelles lutter sont colossales, le sentiment d’impuissance ou de résignation peut être un obstacle à l’action : croire que mon action est trop limitée pour avoir une incidence et faire quelque différence. La panique ou l’angoisse, elles, peuvent être tétanisantes. Puis il y a aussi ces autres formes du désespoir : le déni ou le scepticisme, ou même le relativisme confortable, celui qui argumente avec mauvaise foi afin de ne pas changer les habitudes. La guerre à mener contre le ravage qui vient est aussi une guerre contre le désespoir.
L’espoir, lui, peut signifier du carburant ou de l’énergie pour agir. Mais il peut être aussi un opium laissant croire que « ça s’arrangera, comme cela s’est toujours arrangé », il peut être une drogue pour nous cacher l’effondrement en cours, ou laissant à d’autres (experts, scientifiques, politiques… ?) le soin de trouver des solutions : cet espoir ne pousse pas nécessairement à l’action.
Ainsi, sans que ce soit tout à fait du désespoir, on pourrait souhaiter (et espérer, justement, paradoxalement) une « perte d’espoir » : alors, l’action commencerait réellement. Agissons maintenant car il n’y a aucun espoir à attendre. Hope dies, action begin, disent certains activistes. D’ailleurs, s’il y a lieu de lutter, il n’y a plus lieu d’espérer gagner : en réalité le combat est déjà perdu, il n’a pas eu lieu, l’on n’a rien vu venir.
Mais il y a lieu d’agir, chacun. Actions, petites, locales, concrètes surtout, et les faire voir afin que, tels les cercles excentriques d’une onde de choc, l’on puisse secouer l’inertie et croire en un avenir vivable. Sans doute est-ce l’allégorie bien connue du Colibri. D’où qu’elle vienne, au fond, de l’espoir, du désespoir, de la peur, de la confiance, de quoi que ce soit, tout peut devenir énergie pour agir : on fera flèches de tout bois.
Et sans doute même ces actes donneront-ils davantage aux politiques, aux grandes entreprises, à toutes les forces qui ont un pouvoir d’agir sur les structures de nos sociétés le goût ou l’envie (voire l’intérêt) d’agir dans le même sens.
Agir, il faut le répéter, non pour conserver l’illusion d’un monde révolu, mais pour réduire la portée, l’impact ou les conséquences de l’inévitable catastrophe et effondrement du vivant. Des actions pour préserver autant que faire se peut les (meilleures) conditions (possibles) d’habitabilité du vivant sur Terre (la biosphère) – le vivant dans sa plus grande totalité, diversité, variété, abondance et richesse encore possible. Autrement dit encore, des actions afin que les effets de cet inéluctable dérèglement climatique, de l’effondrement de la biodiversité planétaire et de la pollution généralisée ne produisent pas un futur totalement apocalyptique.
« L’espoir, ce n’est pas l’optimisme. Ce n’est pas non plus la conviction qu’une chose va bien se passer, mais au contraire la certitude que cette chose a un sens, quelle que soit la façon dont elle va se passer. » Vaclav Havel
Est-ce que mon livre peut alimenter une forme d’espoir ? Je le souhaite. Un roman est aussi une action, il agit sur l’intériorité. Les Débris du ciel tente en tout cas de faire sentir ou ressentir de la beauté, ou de réactiver une sorte de mémoire de la beauté, celle que chacun sans doute a connue dans son enfance, à cette époque où l’on s’émerveillait. Et cela, je crois, peut nourrir des forces, le désir de préserver cette beauté, c’est-à-dire aussi d’être attentif et précautionneux du vivant. Il y a cette idée, cette conviction : admirer et contempler, habiter poétiquement la Terre, empêche de sombrer dans la prédation. Et résister au blues par la force d’une vie intérieure intense, généreuse et partagée.
Une autre façon de faire agir ce roman est d’en dévouer les droits d’auteur à une association de protection de la nature : c’est l’engagement que je prends vis-à-vis du lecteur, mes droits sont versés à l’association de protection de l’environnement Natagora (www.natagora.be) (BE53 0682 1403 3153).
« Un jour, nous réapprendrons à nous connecter à ce monde vivant, et l’immobilité sera comme un envol. » (Richard Powers, Sidération)
*
Au fond, je pense que l’émerveillement est politique.
Ce à quoi il faudrait appeler, c’est à une écologie de l’esprit : un rapport respectueux à la nature, une manière d’habiter le monde poétiquement, qui empêcherait de sombrer dans la prédation. C’est-à-dire en fondant cette habitation du monde sur l’émerveillement et la contemplation, sur le soin de la vie : là se trouve sans doute notre vocation, dans ce geste d’amour. Aimer – à deux lettres près – n’est-il pas inclus dans admirer ?
L’émerveillement, cet antidote à la prédation et au profit (bien entendu, en termes de survie, une prédation minimale est inévitable, il faut qu’elle soit raisonnée et aimante). Cette forme de dessaisissement, de lâcher-prise ; cette lutte aussi contre l’usure et l’habitude. Cette manière de retrouver la beauté naturelle et vivante, et de s’en trouver nourri autant que rasséréné, d’en éprouver de la gratitude.
S’émerveiller pour aimer, aimer pour prendre soin et préserver.
S’émerveiller, c’est aussi s’éveiller : ouvrir une mer en soi.
Puis aussi expliquer les comportements, parler d’éthologie, entrer dans davantage de compréhension, indiquer la complexité du vivant, cette sorte de conscience qu’est la vie, la gratitude de ce qui est donné.
L’émerveillement exige l’ici et maintenant – s’opposant au désir tendu vers un avant toujours renouvelé et avide de saisir. L’émerveillement exige la dessaisie dans l’instant et la lenteur, voire l’immobilité, la disponibilité d’un être-là, une suspension du Moi, l’ouverture de la conscience. Le geste ornithologique est une belle métaphore de cela.
Les oiseaux eux-mêmes sont la métaphore de tous nos désirs d’envol (comme le désir de s’envoyer en l’air): ils tendent vers ce ciel, ce sentiment d’unité, d’expansion de la conscience dans un grand tout cosmique, ce que l’on nomme parfois sentiment océanique et que j’aime appeler « vertige vertical ».